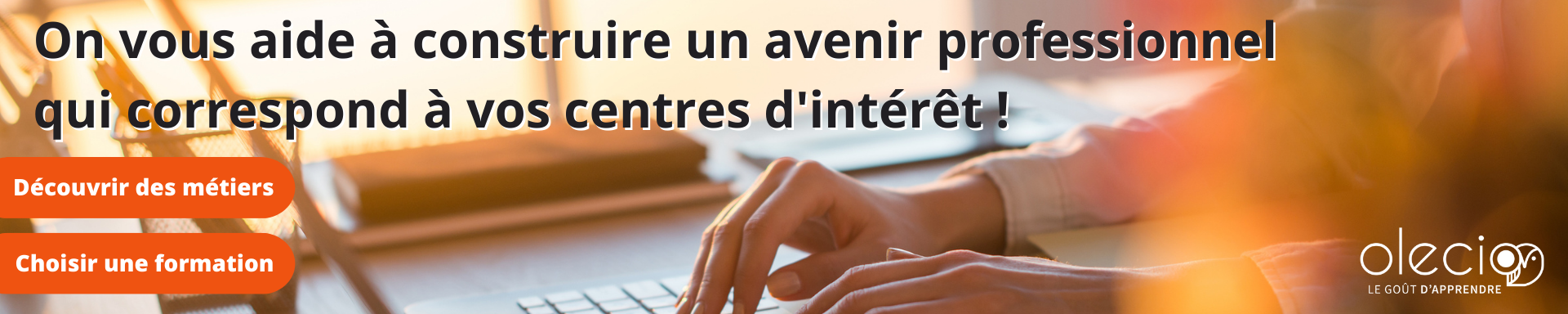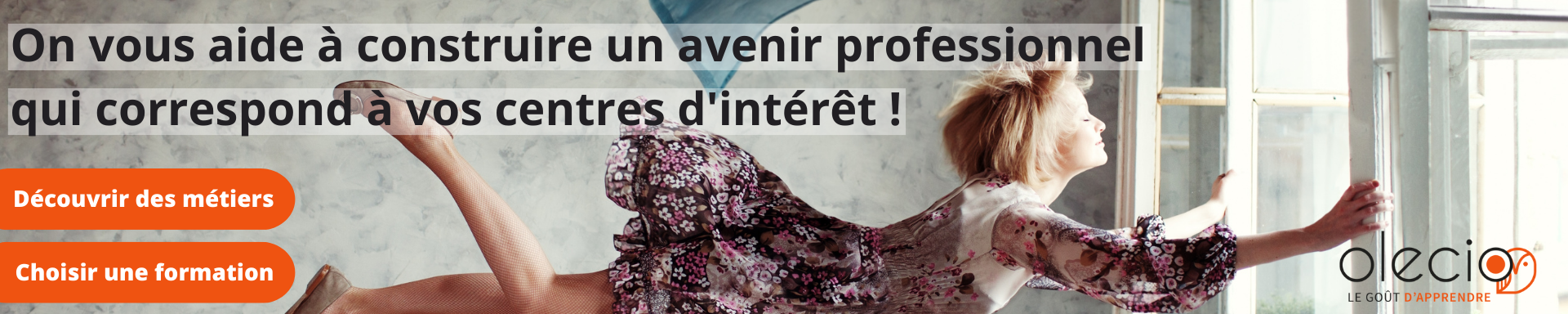Si un pont est le symbole de l’union de deux rives, c’est aussi un lieu de combat et de rivalités. C’est ce que raconte Ivo Andrić dans un roman, souvent qualifié d’historique, intitulé « Le pont sur la Drina » publié en 1945. Situé dans l’actuelle Bosnie-Herzégovine, ce pont a été un lieu d’affrontement avec la Serbie depuis sa construction au XVI° siècle jusqu’à nos jours. L’histoire de cette région des Balkans a de singuliers échos avec ce qui se passe aujourd’hui en Europe. Il est grand temps de le relire.
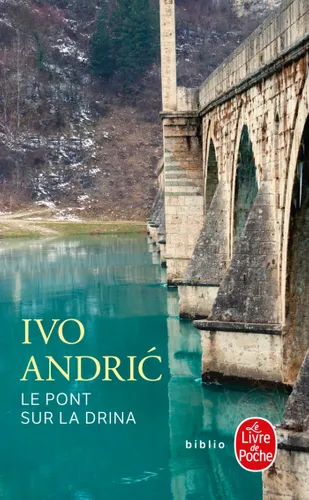
La rivière Drina traverse la Bosnie Herzégovine du sud vers le nord. C’est une rivière tumultueuse non navigable. Elle a toujours été difficile à traverser. C’est la raison pour laquelle, au XVIe° siècle, un Vizir, Mehmed Pacha Sokolovic, décide de faire construire un pont à l’embouchure du fleuve Rzav dans la Drina. A cet endroit, une ville, Višegrad s’est progressivement développée mais la construction du pont va tout changer en permettant des échanges entre celles et ceux qui vivent de part et d’autre du fleuve. Dans cette ville et dans cette région, les habitants se répartissent en trois communautés : orthodoxes, musulmans et juifs. On comprend tout de suite que bien des conflits vont rythmer l’histoire de cette ville. Mais aussi des périodes de paix, de développement et de progrès. Visegrad faisait partie de l’empire ottoman lors de la construction du pont de 1571 à 1576, puis la ville est tombée sous administration de l’Autriche-Hongrie à partir de 1878. Deux façons de gérer différentes qui ont abouti à la Yougoslavie à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
La construction du pont a duré cinq ans pendant lesquelles les esclaves chrétiens ont payé un lourd tribu à ceux qui dirigeaient ce formidable chantier. L’idée du pont revient à un enfant chrétien volé à ses parents au titre de l’impôt du sang réclamé par les Turcs maitres de la région à cette époque. Cet enfant, emmené dans une panière sous le regard désespéré de sa mère, deviendra plus tard et une fois converti à l’islam, commandant en chef de la marine, gendre du sultan, chef militaire de haut rang et Grand Vizir. C’est lui qui s’appelait Mehmed Pacha Sokolovic ( Mehmed-paša Sokolović en bosnien, Мехмед-паша Соколовић en serbe cyrillique, Sokollu Mehmet Paşa en turc dixit wikipedia) et c’est lui qui, se souvenant du pays de son enfance et des difficultés à traverser la rivière Drina, a décidé de faire construire un pont.
La confrontation et la cohabitation de cultures et religions différentes était déjà l’apanage de cette région tourmentée. Mehmed Pacha Sokolovic a voulu relier son village natal Sokolovici situé sur la rive occidentale et dont il fera son nom, avec la rive orientale. Faciliter et aussi relier son village d’origine avec le lieu de sa vie d’adulte, et faciliter et développer les contacts entre la chrétienté et l’islam. Difficile et audacieux projet dont on comprend aujourd’hui toutes les difficultés.
Une fois construit, le pont va se révéler être un ouvrage magnifique avec ses onze arches régulières. La Kapia est un vaste espace situé en son milieu. Il est formé de deux terrasses qui se font face délimitant ce lieu incontournable où les rencontres, les discussions entre jeunes et moins jeunes, entre des groupes venus d’un côté ou de l’autre de la rivière sont quotidiennes. C’est là le cœur battant du pont, le cœur de cette région et de tous ses habitants quelles que soient leurs origines ou religions. Toujours en place, restauré ou réparé après les guerres, le pont Mehmed Pacha Sokolovic a été inscrit au patrimoine de l’Unesco en 2007.
Après qu’il a été construit et que son utilité a été reconnue, le pont n’a pas empêché toutes les calamités de tomber sur Visegrad et ses alentours. Il a fallu faire face à des inondations, le pont permettant de franchir la rivière mais n’assurant pas son contrôle. Il a fallu combattre les épidémies, survivre aux guerres et accueillir les exodes et les réfugiés d’une région ou de l’autre. Rien n’était facile ni évident mais tout, grâce au pont, devint plus aisé. Les occasions de trouver du travail, de faire du profit et de faire du commerce entre les deux rives de la rivière rendaient la vie plus légère voire agréable.
Le pont restera essentiel jusqu’au début du vingtième siècle, date à laquelle une ligne de chemin de fer est construite depuis Sarajevo, et date à laquelle nous explique Ivo Andrić, les partis nationaux et les organisations confessionnelles se créent. Le lien créé par le pont entre ses deux rives a progressivement perdu son caractère essentiel. Les conflits nationalistes vont émerger et amener les guerres des siècles suivants.
Comme pour tout monument chargé de symboles, plusieurs légendes sont venues se glisser entre les arches du pont. On dit qu’un Maure noir est mort écrasé pendant les travaux de construction et qu’il vit dans une des piles centrales du pont. Il sort quand les enfants font des bêtises pour leur faire peur. La légende des jumeaux emmurés vivants est encore plus vivace et étonnante. Dans un petit village, une pauvre fille aurait accouché de deux enfants mort-nés sans comprendre que ces deux enfants avaient été rapidement enterrés. Les villageois avaient donc fini, pour la calmer, par lui expliquer que ses enfants avaient été emmenés à Visegrad, là où les Turcs construisaient un pont. La mère tournait autour du pont cherchant ses enfants qu’elle croyait emmurés. Dans une autre version, les deux enfants, un garçon et une fille ont été capturés par les soldats du vizir et emmurés dans le pont. L’architecte, sous les supplications de la mère aurait placé de fausses fenêtres au travers desquelles on voit, parfois, s’écouler un liquide blanc qui n’est pas sans rappeler le lait maternel.
Dans un style plein de bienveillance pour Visegrad, son pont et ses habitants, Ivo Andric met en place une foule de personnages qui vivent et meurent dans cette ville bâtie sur la rive droite de la Drina. On n’oubliera pas Radisav, serbe qui a travaillé à la construction du pont et qui meurt dans des conditions atroces ni Lotika, directrice juive d’un hôtel louche ou encore Ali Hodja, commerçant turc dont la boutique a été défoncée. Tous ces personnages sont sympathiques, vivent simplement des évènements extraordinaires, s’aiment et se combattent en même temps. Il ne s’agit pas d’une saga, il ne raconte pas l’histoire d’une famille. Les habitants, ouvriers, notables et religieux qui apparaissent ne sont pas liés par des liens familiaux mais par le partage de leur terre d’origine, leur travail et par toutes les difficultés à vivre et à faire face aux exigences des autorités du moment. Et aussi et surtout par ce pont « blanc, inébranlable, invulnérable, comme il l’avait toujours été » (P.340) nous dit Ivo Andric qui ajoute « C’est là que l’on s’imprégnait de la philosophie innée des habitants de Visegrad : que la vie est un prodige incompréhensible, car elle s’use sans cesse et s’effrite, et pourtant dure et subsiste, inébranlable, comme le pont sur la Drina » (P.88)
Le roman s’achève en 1914, année du déclenchement de la Première Guerre mondiale à laquelle succèdera la Seconde. La république fédérative socialiste de Yougoslavie est née en 1945. La Bosnie-Herzégovine en faisait partie mais elle a déclaré son indépendance le 3 mars 1992 ce qui a déclenché immédiatement une guerre le siège de Sarajevo a été l’un des évènements les plus marquants et les plus connus. Dans la ville de Visegrad, les forces serbes ont massacré 3000 bosniaques d’origine musulmane. Certains corps ont été jetés dans la Drina depuis le pont Mehmed Pacha Solovic. Aujourd’hui Visegrad fait partie de la République serbe de Bosnie qui, avec la fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko, forme la Bosnie-Herzégovine. L’histoire n’est pas encore finie.
Ivo Andrić a été couronné par le Prix Nobel de littérature en 1961, de parents croates, il est né en 1892 dans un village de Bosnie Herzégovine qui, à l’époque faisait partie de l’empire austro-hongrois. Après des études à Sarajevo puis à Vienne, il devient à la fin de la Seconde Guerre mondiale, diplomate serbe. Fervent communiste, il représente alors la république fédérative socialiste de Yougoslavie. Il meurt en 1975 à Belgrade bien avant les guerres de 1992 qui aboutiront à l’indépendance de la Slovénie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la Macédoine du Nord.
Le pont sur la Drina
Ivo Andrić
Postface de Pedrag Matvejevitch
Traduction du serbo-croate par Pascale Delpech
éditions Le livre de poche. 9€20
Biblio Romans N° 3321 5 juillet 1999, 384 pages
Edition originale 1945
-Pour en savoir plus (cliquer) sur la Bosnie-Herzégovine actuelle
WUKALI est un magazine d’art et de culture librement accessible sur internet
Vous pouvez vous y connecter quand vous le voulez…
Comment soutenir WUKALI: nous relayer sur les réseaux sociaux (quelques icônes en haut ou en contrebas de cette page)
Contact ➽ redaction@wukali.com