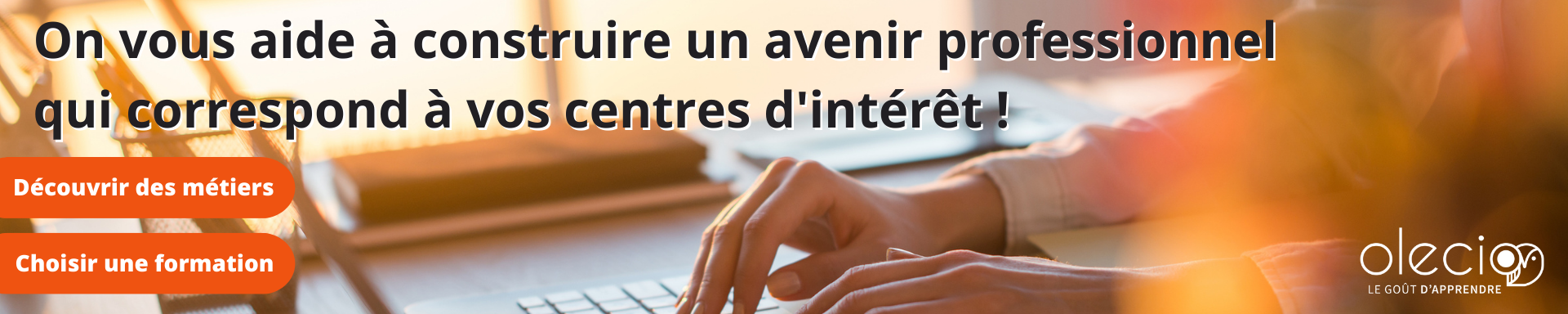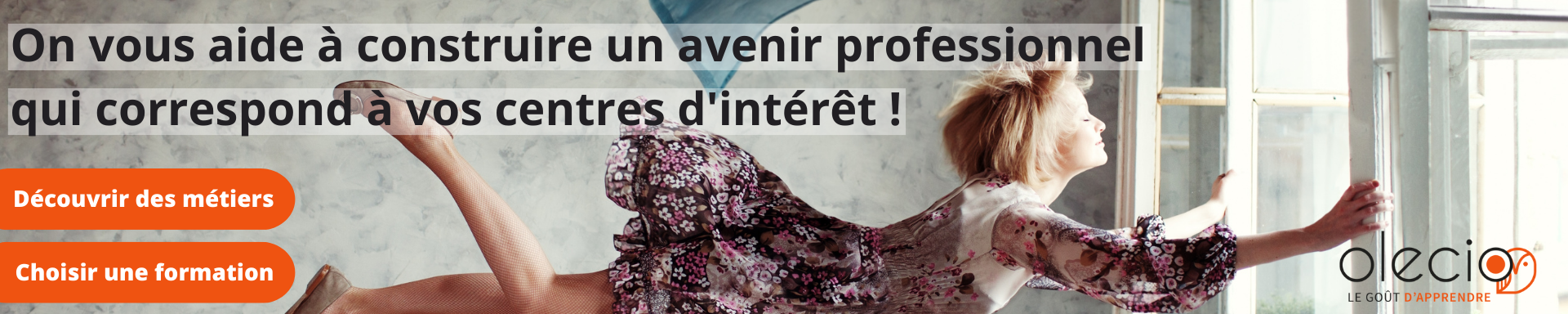Si, depuis deux siècles, l’exercice de la médecine a été bouleversé par des avancées biologiques, thérapeutiques et techniques, il n’en reste pas moins que son exercice comporte quelques incontournables au premier rang desquels celui de la volonté de soigner et de s’occuper des plaintes et douleurs de celles et ceux qui se confient aux soignants.
Il était donc intéressant de confronter deux témoignages de médecins écrits à un siècle de distance. Le premier est celui de Jean Fiolle qui a publié en 1951 un roman intitulé « Hommes au bistouri », le second est celui de Céline Pulcini qui a publié en 2024 un roman intitulé « Dans le tourbillon de la médecine ». Tous deux sont arrivés aux plus hautes fonctions dans la hiérarchie médicale : Jean Fiolle a été Professeur de clinique chirurgicale à Marseille de 1932 jusqu’en 1955, Céline Pulcini est Professeur de médecine et Praticien hospitalier à Nancy depuis 2014. Elle est spécialiste de maladies infectieuses et tropicales. Ils ont écrit des romans qui rapportent la vie du docteur Castel, fils de médecin pour Jean Fiolle et celle de Manon qui rentre en première année de médecine pour Céline Pulcini.

(1984-1955)
Pour être médecin, il faut d’abord suivre des études. Elles ont toujours été longues et difficiles. Avant de rentrer en faculté de médecine, il faut que le futur médecin se demande s’il a ce qu’on appelait vocation au siècle dernier, mot que l’on remplacerait aujourd’hui par la volonté de soigner, de se pencher sur les maladies des patients et sur tout le cortège de douleurs qui va avec. Pour Jean Fiolle, la décision de son personnage a été prise par suite d’un accident de la route où il a dû aider son père à réparer une vaste plaie abdominale. Pour Céline Pulcini, son personnage a toujours été fasciné par « la complexité, la créativité et l’élégance du vivant ». Plutôt que de suivre les traces de son père vétérinaire, elle va s’engager en médecine, discipline où il n’est pas nécessaire d’être manuel contrairement au métier de vétérinaire. Commencent alors des années difficiles.
La première année reste l’un des moments clé de ces études. Difficile, très sélective aujourd’hui, elle faisait suite à une année de Physique-Chimie-Histoire naturelle au siècle dernier. Exigeante mais relativement facile à cette époque, elle comporte de nos jours « des cours majoritairement intéressants qu’il faut apprendre par cœur pour espérer réussir le concours » nous dit Manon. Les études de médecine se caractérisent par l’apprentissage d’une quantité phénoménale de matières qu’il faut comprendre puis apprendre en les répétant mille fois. Et ce n’est qu’à ce prix que l’étudiant sera capable de les restituer au moment des examens.
Une fois passée la première année, les concours arrivent. Deux concours rythmaient les études de médecine au siècle dernier : celui de l’externat d’abord, celui de l’internat ensuite. Maintenant, tous les étudiants sont externes puis internes. Le concours de l’externat a été supprimé, les étudiants sont tous externes. Celui de l’internat, que chaque faculté organisait selon le même schéma mais avec des questions choisies par les enseignants locaux, a été lui aussi supprimé pour être remplacé par une épreuve nationale qui permet, en fonction du classement, d’accéder à la spécialité voulue. Autrefois ces deux concours étaient préparés dans de petits groupes sous l’égide d’un ancien interne qui se chargeait de préparer les candidats. Très sélectif, très exigeant, le concours de l’internat donnait un accès direct à toutes les spécialités. L’étudiant qui n’avait pas réussi ce concours ou qui avait décidé de ne pas le passer, devait alors s’inscrire à un certificat de spécialité qui se clôturait par un examen validant la spécialité visée. Aujourd’hui l’examen national qui remplace l’internat exige lui aussi un travail considérable où « le niveau de stress atteint un niveau impressionnant » nous dit Manon. Il permet de choisir une spécialité en fonction du classement obtenu.
Une fois interne, que ce soit hier ou aujourd’hui, l’étudiant en médecine va se retrouver confronté à des malades auxquels il faudra apporter les soins appris dans les cours. Et il ou elle va devoir s’intégrer dans un l’hôpital où exercent d’autres internes, d’autres médecins chevronnés, bienveillants ou non. C’est une plongée préparée et espérée depuis de nombreuses années où il va falloir trouver sa place. Le choc peut être rude. Manon nous dit : « Presque rien ne colle avec les jolis tableaux typiques qui étaient décrits dans mes bouquins. // C’est l’enfer. Je me sens totalement incompétente » (P.114) Bien des années et peut-être une vie entière seront nécessaires pour marier la théorie apprise avec le réel des pathologies des patients. Pour Jean Fiolle et son personnage, le fils du docteur Castel, les choses arrivent plus progressivement. Les équipes médicales sont beaucoup moins nombreuses, tout le monde se connait. La médecine était beaucoup moins performante, l’apprentissage était donc moins long.
Le mot interne qui s’applique au médecin en formation, tire son nom du temps passé à l’hôpital. L’interne, de nos jours, y passe sa vie avec des semaines de soixante à soixante-dix heures. Les chambres de garde des internes ne se sont guère améliorées au fil du temps. Sales, nous dit Manon, dénuées de tout confort nous dit le fils du docteur Castel. Pas certain que le confort se soit beaucoup amélioré.
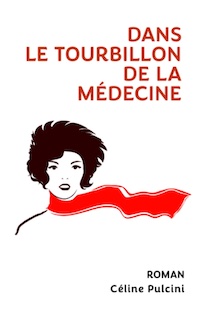
Les externes et les internes, personnages clés du fonctionnement des hôpitaux, sont plus ou moins rapidement intégrés dans le service qu’ils ont choisi. L’hôpital a toujours été un lieu de pouvoir avec une hiérarchie immuable. Cette hiérarchie est établie à la suite de concours et d’examens qui permettent d’obtenir un poste à temps plein ou non au sein de la structure complexe de l’hôpital. Ce poste est souvent couplé avec un poste d’enseignant à la faculté de médecine. « Dès qu’il y a plus d’un Professeur des Universités-Praticien Hospitalier dans un service, c’est rare que les professeurs s’entendent entre eux » nous dit Céline Pulcini, elle-même PU-PH. Jean Fiolle témoigne que « La hiérarchie médicale rappelle de fort près celle du mandarinat et transfigure son homme, qu’on le veuille ou non ». Il confie que « Les médecins entretiennent volontiers des rivalités de boutique ». Témoignages du XX° siècle, tout aussi vrai à l’heure actuelle. Un service a plus ou moins bonne réputation en fonction de la façon dont la pathologie qu’il traite est prise en charge et en fonction du personnel qui y travaille. Le premier d’entre eux, le chef de service, est celui ou celle qui donne le ton et le sens du travail qui y est accompli.
Pour arriver au sommet de la hiérarchie, les sacrifices seront nombreux. Déjà au siècle dernier il fallait avoir une volonté de fer et savoir que, pour un futur PU-PH « la pensée de la lutte loin de m’effrayer, m’excitait vraiment. Une existence heureuse, sans incertitude ni efforts, ne m’eut pas contenté » nous dit le fils du docteur Castel. Ce qui se traduit au XXI° siècle par « J’ai un peu l’impression d’avoir mis ma vie privée de côté// Les vacances sont un rappel doux-amer de ce qu’on sacrifie pour être médecin ». Jean Fiolle ne manque pas de rappeler, qu’à son époque, être neveu du doyen ou avoir des appuis politiques pouvait grandement favoriser une carrière hospitalière.
Au sein de l’hôpital, et quel que soit l’hôpital, il y a une rivalité incontournable qui a toujours existé. C’est celle qui voit s’opposer médecin et chirurgien. « C’est comme un ballet bien réglé » témoigne Céline Pulcini après avoir été au bloc opératoire. Jean Fiolle explique que le chirurgien doit faire preuve « d’une économie de gestes, un silence, une simplicité » lors de tout acte chirurgical. Le geste du chirurgien doit sembler facile et se réaliser sans heurts. Ce qui reste vrai de nos jours. Mais tout n’est pas toujours aussi simple. Le bloc est un lieu où « les relations anesthésistes-chirurgiens peuvent être tendues avec des chirurgiens qui se prennent pour le centre du monde et qui tyrannisent tout le monde » nous confirme Céline Pulcini par l’intermédiaire de Manon. Le caractère dominateur des chirurgiens a souvent été mis en avant. Jean Fiolle en témoigne quand il dit « La médecine est un métier reposant : aucune comparaison avec la chirurgie. En médecine on voit les choses de haut, et sans trop y fourrer les mains// Les médecins ne risquent pas à chaque coup de faire le mal : c’est plus qu’une nuance ». Il n’en reste pas moins que chirurgie et médecine de soins sont des artisanats qui s’apprennent au contact de maîtres et d’ainés qui assurent la transmission du savoir.
Les chirurgiens partagent avec les médecins la même hantise de l’erreur. L’erreur est en soi déjà très culpabilisante. Elle peut mener au dépôt d’une plainte et à un procès. C’était déjà vrai au siècle dernier. Le jeune docteur Castel a vu son père, médecin généraliste, « arpenter, sourcils froncés, sa chambre durant des nuits, pour avoir rédigé une ordonnance pourtant anodine, ou par crainte d’un minuscule procès. Le docteur Castel pouvait s’effondrer à la vue d’un papier timbré d’une assignation ». Manon, héroïne de Céline Pulcini confie que « je me réveille parfois en sursaut la nuit, pensant aux choses que j’ai oubliées dans la journée ». Il faut toutefois reconnaitre avec Jean Fiolle qu’« il est des gens de notre profession (pas beaucoup tout de même) qui prennent les insuccès assez allègrement ». La justice, redoutée par les médecins, aura soin d’essayer de compenser les fautes commises par un médecin. Ce rôle était déjà reconnu par Jean Fiole qui écrit : « je dois rendre compte à celui que j’estropie ; même si je me trompe dans les règles. Tout le reste est foutaise ». C’est souligner la difficulté d’établir la faute et celle de porter le poids de l’erreur avec ses conséquences. Il ajoute que « Un échec imprévu n’est pas compensé par vingt triomphes ». Ce qui était vrai et qui le reste encore de nos jours.

©Hospimedia
La médecine est un métier exigeant qui attire encore beaucoup d’étudiants. A la lecture de Jean Fiolle et de Céline Pulcini, certaines réflexions peuvent permettre d’essayer de comprendre pourquoi. Et de comprendre ce qui fait la spécificité du métier de médecin. Avec des mots qu’on utiliserait plus aujourd’hui, le fils du docteur Castel nous dit que son père avait « une grande et belle foi en sa mission ». Les médecins ont toujours eu conscience d’exercer un métier particulier. Céline Pulcini fait dire à Manon que « Ce n’est vraiment pas un métier comme les autres, il infiltre tout notre être » Jean Fiolle confirme à la fin du roman en disant que c’est « un métier qui comporte une tension intérieure continue et un labeur sans fin ». Tout ceci était, reste et restera vrai.
A un siècle de distance et après bien des bouleversements, la médecine reste un métier qui marie un savoir scientifique avec une attention à des patients venus chercher une écoute, un soulagement ou une guérison. Du premier au dernier jour de l’exercice, l’exigence reste la même. Ce qui n’est certes pas l’apanage de la médecine, mais les enjeux auxquels les médecins doivent faire face ont un caractère bien particulier. Il s’agit de la santé, de la vie et du bien-être de celles et ceux qui se confient à eux. Ce qui est loin d’être anodin.
« Notre existence ne ressemble à nulle autre ; pleine de hasards, mettant sans cesse en jeu l’attention, les réflexes, l’application manuelle, la volonté ; variée à l’infini ; sévère, tendue ; et exposée au regard de tous ». Cette conclusion, que certains trouveront prétentieuse, est celle que le docteur Jean Fiolle fait dire à son personnage en 1951. Elle pourrait être dite par Manon, le personnage du docteur Céline Pulcini. Et par les médecins d’aujourd’hui, jeunes ou vieux.
Dans le tourbillon de la médecine
Céline Pulcini
éditions Librinova, 2024, 316 pages, 20€90
Hommes au bistouri
Jean Fiolle
éditions Segep, 1951, 356 pages
WUKALI est un magazine d’art et de culture librement accessible sur internet*
Vous désirez nous contacter pour réagir à un article, nous faire part de votre actualité, ou nous proposer des textes et des sujets
➽ redaction@wukali.com
*Vous pouvez vous connecter quand vous le voulez et bien sûr relayer nos articles sur vos réseaux sociaux, par avance merci !