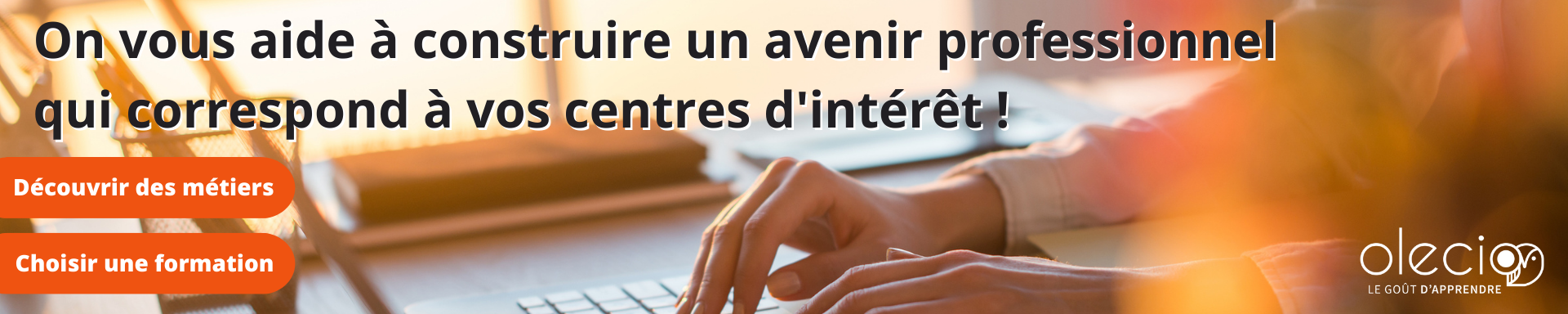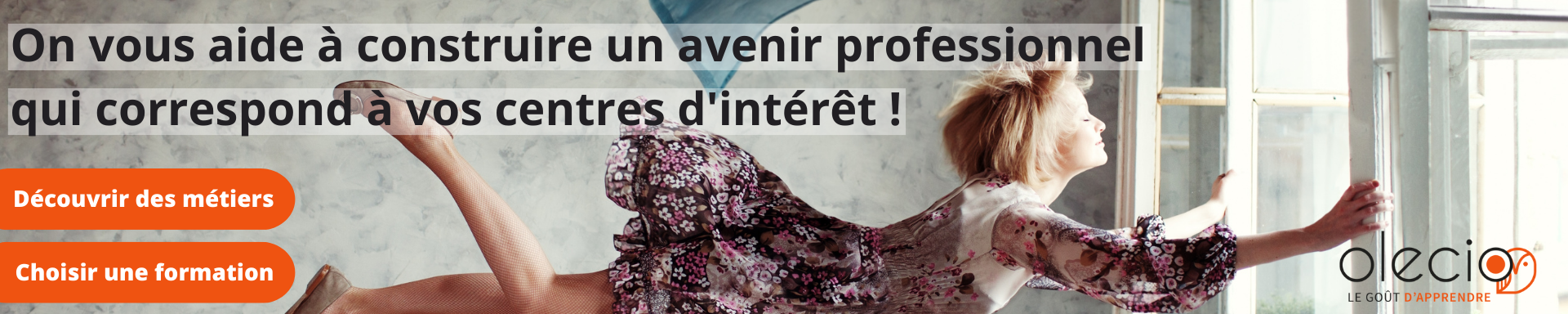La voie du large de Michèle Finck : une chronique des années Covid mais bien plus. Marquées par les disparitions, par le confinement et l’isolement, ces années étaient celles où la mort était omniprésente, celles où elle régnait sur les esprits et où chacun s’attendait à ne plus être là ou à perdre un parent, un ami, un voisin.
Pourtant, dans cette atmosphère de fin du monde, la vie restait présente et finalement, c’est quand même elle qui a gagné. Même si les douleurs, les absences, les plaies restent vives, c’est la vie qui est restée là et c’est ce que nous raconte ce recueil dont le titre joue sur les mots. La voie du large c’est aussi la ou les voix du large, celles qui viennent de loin, celles qui ne sont plus là, celles qui nous parlent encore et toujours, celles que l’on entend si faiblement mais si distinctement grâce à Michèle Finck.
Son amie, celle qu’elle appelait L’aimée est partie un vendredi saint. Comme le Christ, c’est elle qui nous le fait remarquer. Mort attendue et aussi paisible que possible, cette mort vient en écho à celle de son père. Mort qui rentre dans l’ordre des choses mais qui reste douloureuse. Et avec ces deux morts si différentes mais si semblables, c’est toute la vie qui se vide de deux présences irremplaçables. Pourtant, les mots, la poésie, la musique vont permettre de continuer à vivre, ressentir, aimer.

L’âpre ébauche : le titre du premier chapitre pourrait être le sous-titre du recueil tant la vie parait, est âpre et la poésie, elle, sera toujours et à jamais une ébauche d’un mode vie, une ébauche d’un monde apaisé et serein. La poésie, comme la vie, n’est qu’une laborieuse et difficile ébauche de quelque chose qu’on ne maîtrisera jamais, qui n’aboutira jamais mais qui sera construit avec des mots. Ce ne sera qu’une ébauche, jamais un vadémécum définitif et complet. Pour expliquer cette impossibilité, Michèle Finck fait appel au doute qui évite tout blocage. Il y a un jeu dans toute connaissance, dans toute parole et dans toute vie. En explorant la langue du doute elle conclue ce chapitre par « Lucidité du doute ouvre le large ». Le doute est donc indispensable pour comprendre, vivre et aller en avant.
Suit ensuite une véritable chronique de la première pandémie en dix-sept stations qui font penser au chemin de croix de la tradition chrétienne dont Michèle Finck est proche sans pour autant y adhérer sans réserve. « Poignard en moi de ne pas pouvoir prier » nous confie-t-elle en plein confinement. Face à la mort qui envahit tout, les interrogations les plus dures surviennent « Si Dieu existe prend-il aussi des somnifères ? » Eternelle question posée dans un vers où les blancs espacent les mots, procédé que Michèle Finck utilise souvent. Un rappel du doute omniprésent ?
Intermezzo intervient ensuite comme pour se laisser un temps de repos. Le confinement est fini. L’envie de rencontrer est partout, même sur les murs où le poème le plus court de toute la poésie italienne trouve un autre sens quand elle lit « Quand je te vois/ M’illumino /D’immenso ». Giuseppe Ungaretti n’en voudra pas à celui qui a inscrit son poème sur un mur de Paris, même s’il y a une faute d’orthographe. La vie reprend, la poésie ressort. Verlaine, Nerval, Paris et Strasbourg s’illuminent de nouveau.
Avec Correspondance stellaires, Michèle Finck écrit des lettres à plusieurs poétesses et poètes disparus. Elle écrit nous dit-elle. Elle ne veut en aucun cas commenter, elle veut discuter, parler de poésie. Avec Rainer Maria Rilke elle veut parler de ce « qui est primordial : ce va et vient de la vie et de la poésie ». Chez Michèle Finck, la vie et la poésie sont un seule et même chose Elle poursuit en lui disant « Poésie/est question. Jamais réponse ». Tout ou presque, est dit. Elle écrit plus loin à Nelly Sachs et Paul Celan qui sont en couple et à Tsvetaieva, Pasternak et Rilke qui partagent une même amitié. Toutes et tous sont en écho à l’ «Absolu de l’amour/ et absolu de la poésie. » Dans toute cette correspondance, La voie du large est toujours proche du quotidien, s’adresse à une lectrice ou un lecteur comme à un confident. L’âpre ébauche se construit peu à peu. Page après page l’ébauche se précise sans jamais devenir certitude ni œuvre finie. L’ouverture sur le large est présente dans chaque vers, dans chaque poème, dans chaque chapitre qu’il soit versifié ou en prose.
Santa reparata, chapitre suivant, vise comme son nom l’indique à réparer tout en rappelant que c’est « le doute qui verse de l’eau de mer/ dans les douves du château ». Le doute est toujours présent. On peut reconnaitre l’influence de Yves Bonnefoy dans ce vers de Michèle Finck. La mer, la vue du large apparaissent dans les poèmes qui s’enchaînent comme des vagues bienveillantes. Brume de mer, poème qui vise la quiétude et l’apaisement confie « Et quand tu es déchirure/ loin de la mer/ et que le désespoir l’effroi/ montent en toi/ comme un râle un désert /laisse -les être/ estompés/par le coup de pinceau léger / de la brume intérieure »
Brume de mer se termine par
Quel
oiseau
désirer encore
étreindre
avant d’entrer
bras ouverts
dans l’ultime
brume
de
mer
?
Il faut respecter et accueillir la brume intérieure qui saura estomper le sombre, le sinistre de l’effroi et du désespoir. Les espaces blancs soulignent l’ouverture des bras tout comme l’oiseau ouvre sur un espace infini. L’âpre ébauche réserve quelques moments d’apaisement et de tranquillité y compris face au manque, à la perte et à la mort. Face à une nature, face à une mer qui montre un infini qui n’inquiète pas mais rassure, Michèle Finck appelle ces tourments « brume intérieure ». Ce qui est beaucoup moins lourd que les nuages noirs auxquels il est souvent fait allusion dans les mêmes circonstances.
Si les liens de la poésie avec la musique sont parfois discutés et compliqués, il faut lire le chapitre intitulé Radiophilie pour comprendre que ces liens sont étroits. Le père de Michèle Finck, mélomane averti et grand amateur de musique a transmis et partagé avec sa fille les subtilités de bien des chefs d’œuvre depuis le concerto pour violon de Mendelssohn jusqu’à Orphée et Eurydice de Gluck. « Devant / La /musique/ Le Poème/ Tremble/ De Reconnaissance ». C’est la musique qui est première, la poésie ne vient qu’après pour mettre en forme, pour montrer ce que la musique a ouvert. C’est par la musique qu’elle comprend que, dans sa vie, « L’amour serait désormais son épicentre et la musique sa formule ».
Dans le dernier chapitre « Cantillation du doute et de la grâce », les deux thèmes du recueil, le doute et l’ébauche se rejoignent face à un ciel inatteignable. « Serait-ce donc cela/ L’âpre ébauche ? /- Essayer d’ébaucher/ Dieu ? » . Et surtout ne pas se remplir de certitudes, il y aura toujours un doute qui pour rendre l’ébauche possible mais jamais finie. « Garder/ Toujours/ Dans / La main / Un pétale / De / Peut-être » .
La voie du large se lit comme on suivrait une conversation avec un ou une amie qui se raconte, qui parle de sa vie et de sa façon de vivre, de ses amours et de ses passions tout autant que de son travail et de ses obsessions. Rassemblées dans des poèmes et des textes en prose, toujours ouverts sur un possible, ces différents chapitres nous emmènent dans le profond d’une conscience et d’une expérience de la vie que seule la poésie permet. Et ouvre.
La Voie du large
Michèle Finck
éditions Arfuyen. 17€50
illustration de l’entête, Michèle Finck ©photo DNA
WUKALI est un magazine d’art et de culture gratuit et librement accessible sur internet
Vous pouvez vous y connecter quand vous le voulez…
Cet article vous a intéressé, vous souhaitez le partager ou en discuter avec vos amis, utilisez les icônes des réseaux sociaux positionnées en haut ou en contrebas de cette page
Contact ➽ : redaction@wukali.com